La transe cognitive auto-induite (TCAI) et l'hypnose.
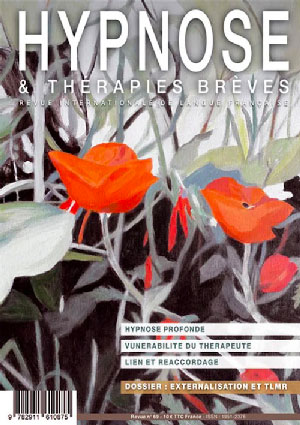
Dialogue avec François ROUSTANG
La transe, un don issu du chamanisme, ou une compétence enfouie en chacun de nous ? En s’appuyant sur la parole de François Roustang, dans un exercice à deux voix, l’auteure dresse ici un parallèle entre la TCAI et l’hypnose.
Qu’est-ce que la transe cognitive autoinduite (TCAI) ? Fruit de l’expérience de Corine Sombrun dans la pratique de la transe dite « chamanique », la TCAI est issue d’une méthodologie qu’elle a développée pour accéder à un état de transe réversible, accessible à une majorité, induit par la seule volonté, et abstrait de tout rituel associé aux cultures traditionnelles dites « à chamane ».
Le nom et la pratique de la TCAI ont été popularisés par des ouvrages tout public, et le film de Fabienne Berthaud Un monde plus grand (2019). Celle-ci fait aussi l’objet de recherches scientifiques dans le domaine des neurosciences et de la clinique, et d’enseignement pratique. Je vais ici vous présenter ce que j’ai compris de la TCAI, de ses incroyables potentialités dans le champ de l’exploration d’une psyché enfin réunie avec le corps, et de ses très probables applications psychothérapeutiques. Pour cela, je m’appuierai sur ses rapports de ressemblance et de dissemblance avec l’hypnose avec, à mes côtés, le grand François Roustang pour m’aider à penser et dé-penser la transe. J’espère que de là où il est, il ne jugera pas mes emprunts (en « italique » dans le texte) (1) impertinents.
QU’EST-CE QUE LA TRANSE / LES TRANSES ?
« Et il y en a encore qui voudraient que la transe soit une expérience intérieure, ou, plus cocasse, un état modifié de conscience.
Ils n’ont vraiment rien compris (…) D’abord on ne sait pas ce que signifie conscience tant que l’on n’a pas dit de quoi elle était conscience et tant que l’on n’explique pas de quelle nature est la modification. » La modalité « transe » vécue en hypnose comme en TCAI résiste à la classification et à la description. « Chaque fois que l’on me demande de parler ou d’écrire à propos de ma pratique je suis dans l’embarras. (…) Tout ce que je croyais avoir compris ou pensé n’est plus que du sable qui glisse entre mes doigts. (…) Tout se passe comme si on ne pouvait pas construire un discours qui rendrait compte de la chose, ou du moins comme si ce discours ne cessait pas de se déliter au fur et à mesure de sa production. Si je suis en transe, je n’ai pas à l’égard de la transe la distance suffisante pour la décrire, j’y suis enfermé et même si je reste quelque peu conscient, je ne peux rien en dire. Mais si je ne suis plus en transe, et si je me demande ce qui s’est passé, la transe m’échappe. » Les théoriciens de l’hypnose peinent parfois à différencier ce qui relève de l’hypnose et de la modalité transe qui appartient à l’hypnose. « Il n’y a qu’une solution : sans cesse tenter de réfléchir sur l’expérience et sans cesse reconnaître et sentir que tout ce que nous disons reste une approche insuffisante. Toute théorisation de l’hypnose (de la TCAI) est autodégradable. »
Psychiatre psychothérapeute formée en hypnose, j’ai pendant très longtemps tourné autour de ce mot « transe » pour mieux le comprendre, concept qui semblait se dérober à chaque fois qu’il me semblait l’approcher, « savoir qui ne se distingue plus de l’action elle-même ». En découvrant la TCAI avec Corine Sombrun, j’ai enfin compris qu’il fallait « cesser d’y réfléchir davantage sans quoi on ne peut pas s’en dépêtrer (Wittgenstein cité par Roustang), la vivre : faire cesser la réflexion ». Plutôt que de céder à une tentation syncrétiste, il me semble plus enrichissant de différencier les différentes formes de transe, et de m’appuyer ici sur la connaissance de l’hypnose pour mieux tâcher de cerner ce qu’est la TCAI, décrire de grands cercles comme le loup ou le chien et essayer de m’en approcher au plus près même si je sais le sujet insaisissable. Car « comment décrire un dedans lorsqu’on est dehors ? ».
DES ORIGINES DE LA TRANSE À LA PRATIQUE DE LA TCAI
« Depuis la nuit des temps, il existe des sorciers, des chamans, des medicin men, des prêtres... et leurs techniques de guérison font largement appel à des procédés et des processus extrêmement proches de ceux que nous référons sous le terme d’hypnose. L’hypnose est la mère de toutes les thérapies » (2). Avec Thierry Melchior mais en évitant ce contresens temporel, disons que les transes sont les mères de toutes les thérapies. « Il faut replacer l’hypnose dans les millénaires de son histoire et de sa géographie où la transe se ramène toujours à une transe de possession. (…) Cela veut dire que l’individu doit laisser venir quelque chose des puissances qui le dépassent et qui sont hors de lui. » Le mot transe fait forcément référence aux cultures des peuples premiers et au chamanisme, même si certains anthropologues comme Charles Stépanoff évitent soigneusement d’utiliser ce mot et parlent de « techniques de l’imagination », de « perceptions non sensorielles », de « scènes de possession collective », d’« imagination agentive », de « corps ouvert » (3). « L’imagination apparaît alors comme ce qui nous fait voir, entendre et sentir un visible qui se dérobe le plus souvent à nos capacités ordinaires de voir, entendre et sentir. » Les vécus de transe sont généralement reliés à une expérience initiale marquante révélant un don, dans un cadre culturel qui va encadrer et développer ces capacités, lors de processus d’initiation et d’apprentissage. Après avoir vécu des expériences de transe induite par des psychotropes en Amazonie et y avoir fait le rêve d’un son diphonique typiquement mongol (4), Corine Sombrun se rend en Mongolie pour y enregistrer pour la BBC une cérémonie chamanique. Au cours de cette cérémonie, elle expérimente un état de transe qui la mènera à suivre une initiation et un enseignement auprès d’une chamane tsaatan, Enkhetuya. Plutôt que de se réclamer d’un statut et d’une culture qui ne sont pas les siennes, Corine cherchera ensuite pendant de longues années à comprendre et objectiver, à l’aide de la science occidentale, ce qui lui est arrivé, les capacités qu’elle a développées, afin que celles-ci puissent profiter à tous ceux qui le souhaitent. En effet, elle a l’intuition qu’il ne s’agit pas d’un don exceptionnel mais d’une compétence enfouie en chacun d’entre nous. C’est ainsi qu’elle a développé ce qu’elle nomme la transe cognitive auto-induite (TCAI).
A LA DÉCOUVERTE PRATIQUE DE LA TCAI
« En quoi va constituer cet apprentissage ? A ne plus penser et ne plus sentir, pour que la pensée et le sentir soient portés à leur optimum de puissance. Vous allez vous engager sur un chemin que vous ne connaissez pas pour aboutir en un lieu que vous ignorez en vue d’accomplir ce dont vous êtes incapables. » Que se passe-t-il lors d’un stage d’introduction à la TCAI ? Les participants et les participantes sont, dans un premier temps, allongés par terre sur un matelas, les yeux fermés (ensuite, la position de départ n’aura plus beaucoup d’importance). L’idée est que le corps soit le plus disponible possible à l’émergence d’un mouvement. Les yeux fermés permet tent de se concentrer dans un premier temps sur ses processus internes, plus tard sur l’environnement. Le mot d’ordre : « Surtout ne faites rien, laissez faire, laissez émerger ce qui se présente à votre corps, à votre voix, ne réprimez pas le geste qui se présente, les sons que votre voix veut bien émettre. » Les participants et participantes vont alors entendre l’inducteur qui est une bande de sons digitaux créée par Corine Sombrun et Elie Le Quéméner à partir de l’analyse spectrale de séquences de tambour chamanique mongol produites par Corine Sombrun. Cette écoute « a pour visée la destruction (ou en TCAI, le repositionnement) de notre système de coordonnées figé ou restreint et, par le fait même, nous ouvrir, fût-ce quelques instants, à un nouveau complexe relationnel souple et ample ».
Un premier effet de suggestion provoqué par ce que les participants et participantes savent déjà de la TCAI en arrivant à un premier stage, par les attentes importantes voire magiques qu’ils et elles en ont, avec l’expression de certains besoins démonstratifs, n’est bien sûr pas à exclure, mais résiste difficilement au temps et à l’exercice dans la majeure partie des cas. Lors de ce stage d’introduction de quatre jours, les participants et participantes seront amenés à traduire de manière autre que seulement verbale ce vécu particulier et ce qu’il peut déclencher comme processus créatif afin de « briser, faire voler en éclats la perception expérimentée tous les jours ».
QUEL EST LE VÉCU LORS DE TCAI ?
Que décrivent les participants et participantes aux stages de TCAI ? Après une ou plusieurs écoutes, ils et elles vont vivre des sensations physiques, faire des mouvements et des sons non décidés, avoir des images internes, des liens avec des éléments de contexte ou d’histoire. Des expériences diverses dont le point commun est qu’ils et elles se surprennent à faire l’expérience de diminuer leur contrôle volontaire, leur esprit de jugement, font état de compétences qu’ils et elles n’auraient pas pu exercer avant ou hors processus de transe, expérimentent une sensibilité nouvelle tant quant à leur vécu interne qu’avec leur environnement, leur histoire. Ils et elles expérimentent « un mode perceptif qui n’est plus soumis à l’intellect et donc une sensorialité qui se joue des impératifs du temps et de l’espace coutumier, qui saisit les objets dans leur illimitation et donc dans leur mélange, qui adhère à la situation au point d’entrer dans les choses, qui échappe à la réalité visible pour voir avec l’imagination (…), il laisse apparaître l’âme sentante. (…) La pensée se rend meuble et souple, elle s’insinue dans le corps pour ne plus s’en distinguer (…), la pensée n’est plus quelque chose à part qui surplomberait comme un nuage et qui nous tiendrait sous la menace d’une grêle d’intelligence, elle est la rosée du matin ensoleillé qui imprègne nos corps. Nos corps pensent. » Comme dans l’hypnose,...
Pour lire la suite en vous procurant la Revue Hypnose et Thérapies Brèves
ISABELLE PHILIPPE
Psychiatre FMH enfants et adolescents, psychothérapeute systémicienne, formée en hypnose, thérapies brèves, thérapie narrative, psychotraumatologie et addictologie, elle est de la première volée à se former en transe cognitive auto-induite avec Corine Sombrun et à en explorer les applications possibles en thérapie. Elle travaille en Suisse, entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds au Cerfasy, centre de recherches familiales et systémiques, comme psychothérapeute, superviseuse et formatrice.
Commandez la Revue Hypnose et Thérapies Brèves 69
Achat du numéro 69 de la revue Hypnose & Thérapies Brèves en version papier
10€ TTC, frais de livraison compris pour la France métropolitaine.
Les frais de port seront ajustés automatiquement au cours de la commande pour tout achat hors France métropolitaine.
Lorsque la Version papier de ce numéro sera épuisée, la version PDF sera fournie à la place
Sommaire de ce n°69 présenté par Julien Betbèze, rédacteur en chef:
Quel plaisir de lire un texte de Dominique Megglé sur un sujet comme l’hypnose profonde.
En quelques lignes, il nous fait comprendre l’importance de ce type de transe. Savoir la reconnaître, savoir la demander, oser faire des suggestions directes, être attentif à l’amnésie et donner des suggestions post-hypnotiques : tous les lecteurs de Dominique Megglé savent que ces points sont au centre du travail d’Erickson et qu’ils permettent d’accéder à la singularité créative du sujet. Une leçon de clinique hypnotique pour améliorer notre pratique !
Après nous avoir montré l’importance de retrouver la relation dans le travail de deuil, François Cartault prolonge son propos en montrant la nécessité de créer du sens à partir des valeurs partagées avec le défunt. Nous voyons comment cette conversation reconnecte le sujet avec ce qui était vivant pour lui dans l’histoire passée et rend possible le développement de nouveaux chemins de vie.
Isabelle Philippe s’appuie sur le travail de François Roustang pour nous faire découvrir la transe cognitive auto-induite (TCAI), terme utilisé par Corine Sombrun pour nommer, dans notre culture occidentale, ce qu’elle a expérimenté dans la transe chamanique. Cet article nous permet de comprendre comment s’organisent l’expérience et les perceptions lors de TCAI et le lien avec une vision de l’hypnose comme modalité de la vie.
Karine Ficini nous expose comment retrouver sa capacité désirante après des épisodes de maltraitance sexuelle.
Michel Lamarlère décrit, avec plusieurs exemples cliniques, le rôle de la réification et de l’externalisation du contexte pour faire émerger de nouvelles significations porteuses de sens ; il souligne l’importance de rester dans une position de ''non-savoir'' pour accompagner le processus de réassociation.
Enfin Géraldine Garon nous donne une nouvelle lecture d’Harry Potter où des ponts se créent entre magie et thérapie, la ''pensine'' prenant des airs d’externalisation. Et comme le dit le professeur Dumbledore : ''Il suffit d’extraire les pensées inutiles de son esprit et de les déverser dans cette bassine pour pouvoir les examiner plus tard tout à loisir'' ; J. K. Rowling nous rappelle que le changement ne se résume pas à des techniques ou à des tours de magie : la relation humaine reste la vraie star d’Harry Potter.
Et n’oubliez pas les rubriques habituelles, Stefano Colombo et Muhuc nous plongent dans l’ivresse des profondeurs, Sophie Cohen nous ''en-chante'', Adrian Chaboche s’autorise à ne pas savoir, et Nicolas D’Inca nous incite à prendre soin de nos démons intérieurs.
Espace : Douleur Douceur
. Marc Galy révise le stoïcisme !
Les ingrédients de la relation thérapeutique tels que proposés par Marc Galy, à savoir : la présence, la posture juste, l’écoute non armée, l’espace de l’attente, nous font clairement sentir que la résilience est la force de la faiblesse.
. Marie-Anne Jolly tisse des liens
. La corporéité, au cœur de la rupture, entre le savoir objectivant et la parole singulière. Le sujet ne fait l’expérience de la relation positive avec le thérapeute en tant qu’être humain et non seulement comme patient que dans la mesure où il va intégrer corporellement les intentions positives du thérapeute et c’est là que l’accordage peut se mettre en place.
Comme nous l’enseigne Julien Betbèze, plus je suis en relation avec l’autre, plus je suis en relation avec moi, cela signifie que plus je suis en relation avec l’autre (je rentre dans son monde, je lâche prise) et plus je suis en relation avec moi, plus je suis libre. Et plus je suis en relation avec moi, tout en étant différent de ce qu’est l’autre, plus l’autre est en relation avec moi (il est alors en capacité d’accueillir les intentions positives dans ma différence). Je suis créatif non pas contre lui mais pour agrandir notre relation. L’un et l’autre sont libres dans un mouvement plein de relations, dans une nécessité de relation. S’il n’y a pas ce partage affectif, on ne peut pas exister en tant que sujet. Tous les processus de réassociation qui permettent au sujet de se sentir incarné et libre passent par cette relation sécure à l’autre, le sujet se sentant validé dans son existence et autorisé dans ses prises d’initiative à construire un monde plein de sens.
De façon très habile, Marie-Anne Jolly fait intervenir le prisme de la théorie polyvagale dans le processus de ré-association et de ré-accordage.
. Philippe Rayet prend le taureau par les cornes pour le plus grand bien de sa patiente. Une spectaculaire guérison d’une douleur post-traumatique en quatre heures ! Philippe Rayet nous fait entrer de plain-pied dans l’arène d’un syndrome douloureux dont souffre l’agricultrice Michèle, bousculée par une vache. C’est par la maîtrise de l’hypnose et de l’EMDR que l’auteur nous présente tout le déroulé du soulagement de sa patiente. Sa finesse clinique lui enjoint de croire à juste titre qu’une douleur n’est jamais neuve. Philippe Rayet ne se contente pas en effet de permettre le soulagement total des symptômes, mais il s’enquiert par l’anamnèse de mieux comprendre le terrain qui a favorisé la dimension traumatique. Son oreille attentive et discrète, que rien n’effraie, qui ne juge pas, peut être qualifiée de divine douceur. Je ne peux que souscrire au titre très parlant de son article : ''Victime d’une vache, elle boit du petit lait'' grâce à l’hypnose... et j’ajouterai : voici une thérapie vachement bien menée !
Livres en bouche
Crédit photo © Suzan RAYFELD
- Thérapies et Médecines Complémentaires
- Revue Hypnose et Thérapies Brèves
- Affichages : 9520

