Pr Jean Benjamin STORA et la psychosomatique intégrative.
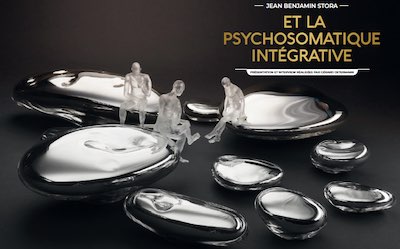
PRÉSENTATION ET INTERVIEW RÉALISÉES PAR GÉRARD OSTERMANN pour la Revue Hypnose et Thérapies Brèves.
I. HISTOIRE DE LA PSYCHOSOMATIQUE
Les théories classiques de la psychosomatique, souvent inspirées de la psychanalyse, se sont concentrées sur une causalité linéaire pour expliquer la relation entre le psychique et le somatique. Cette vision réductionniste tend à interpréter les maladies organiques comme des somatisations, attribuant un sens symbolique à des dysfonctionnements biologiques. L’attitude psychosomatique remonte aux premiers âges de la médecine, quand elle était encore imprégnée de magie, de religion et des idées de possession, de faute, d’exorcisme et d’expiation. Est-ce la raison des préventions contre la médecine psychosomatique en qui l’on verrait un retour aux pratiques superstitieuses ?
La réhabilitation du subjectif et de l’irrationnel comporterait- elle le risque d’une régression et d’un obscurantisme autorisant ignorance et charlatanisme ? On trouve partout cités les bâtiments d’incubation des temples d’Epidaure où les maladies incubaient leur guérison miraculeuse. Dès l’Antiquité gréco-romaine, deux mouvements fondamentaux s’opposent, symbolisés par l’école de Cos et l’école de Cnide. Pour l’école de Cos, celle d’Hippocrate, la pathologie est dynamiste, la maladie est une réaction, la médecine doit être vitaliste, totaliste, humorale, biologique et synthétique. Pour l’école de Cnide, celle du galénisme, la pathologie est mécaniste, la médecine anatomiste, solidiste, analytique ; la maladie est un accident. Socrate revenant de guerre déclarait : « Les Thraces sont en avance sur nous, ils savent que le corps ne peut être guéri si l’on ne soigne pas en même temps l’esprit. » La première hypothèse psychosomatique est fournie par Galien pour qui la « pneuma-psyché » allait du cerveau au reste du corps grâce à la « tuyauterie » nerveuse. L’introduction du terme « psychosomatique » par Johann C.A. Heinroth au début du XIXe siècle marque un tournant décisif.
Convaincu que l’âme englobait le corps, Heinroth posa les bases d’une médecine où les pathologies mentales et certaines maladies somatiques relevaient avant tout de l’âme. Sigmund Freud, quant à lui, complexifia ce rapport en introduisant une vision dualiste : un appareil psychique séparé du corps, uniquement lié par la notion de pulsion. Cette dissociation théorique a influencé des générations de cliniciens, mais a aussi limité leur capacité à comprendre la complexité des interactions entre corps et esprit. Malgré les avancées notables, la psychosomatique contemporaine semblait incapable de dépasser ses contradictions. Alors que l’idée d’un dialogue corps-esprit tend vers un monisme unificateur, la pensée clinique reste piégée dans un cadre dualiste. Ce paradoxe se manifeste par des diagnostics flous, tels que les troubles somatoformes ou la somatisation, souvent perçus comme opportunistes et peu utiles en pratique. En conséquence, la médecine a parfois recours à des solutions simplistes, allant du dénigrement des symptômes du patient à une chronicisation des troubles par manque de prise en charge adéquate. La psychosomatique intégrative place la relation au centre de son paradigme. Dès la vie intra-utérine, l’individu évolue dans un réseau relationnel qui influence son développement et sa santé. Ce concept inclut des dimensions aussi diverses que le psychologique, le génétique et l’immunitaire. Par exemple, les pathologies auto-immunes ou allergiques sont envisagées non comme des dysfonctionnements isolés, mais comme des manifestations d’impasses relationnelles.
 II. L’APPORT DE JEAN BENJAMIN STORA
II. L’APPORT DE JEAN BENJAMIN STORA
Le Professeur Stora est considéré comme une figure majeure dans le domaine de la psychosomatique, ayant contribué significativement à l’évolution de cette discipline en France et à l’international. Dans les années 1990, il développe la psychosomatique intégrative, marquant une rupture avec les approches traditionnelles. Cette nouvelle discipline s’appuie sur :
1. Les avancées en neurosciences.
2. Les nouvelles disciplines comme la psycho-neuro-immunologie et la psycho-neuro-endocrinologie.
3. L’intégration du modèle psychanalytique avec les découvertes récentes en biologie et neurosciences.
La psychosomatique intégrative considère l’être humain comme une « unité psychosomatique », un système complexe comprenant :
- le système psychique ;
- le système nerveux central ;
- le système nerveux autonome ;
- le système immunitaire ;
- le génome.
La psychosomatique intégrative étudie les interrelations dynamiques entre ces systèmes, leurs équilibres et déséquilibres. Elle propose une vision globale du patient, intégrant les dimensions biologiques, psychologiques et neuronales, tout en prenant en compte le contexte familial et professionnel. Cette évolution vers la psychosomatique intégrative représente une avancée majeure dans la compréhension et le traitement des maladies, offrant une perspective plus complète et scientifique sur les interactions complexes entre le corps et l’esprit. Le travail du Professeur Stora nous aide à repenser l’Approche thérapeutique. Il est en effet urgent de redéfinir notre rapport au corps et à l’âme dans une perspective véritablement holistique.
Plutôt que de plaquer des interprétations sur les symptômes, il faut adopter une posture d’« ignorance fondamentale », où le patient est replacé comme expert de son propre vécu. Cela implique de reconnaître l’« intelligence du corps », concept défendu par François Roustang, et d’écouter les récits et images que le patient associe à sa souffrance. Le corps doit être envisagé comme un médiateur, un espace de dialogue entre le soignant et le patient. Les thérapies psychocorporelles offrent des voies prometteuses pour redonner au corps sa place centrale. Ces approches nécessitent une collaboration interdisciplinaire et une ouverture d’esprit, loin des paradigmes rigides de la causalité psychique. La psychosomatique intégrative est une médecine du respect et de l’écoute, une médecine respectueuse et attentive qui doit non seulement valider la souffrance du corps, mais aussi réhabiliter la parole du patient, en évitant les jugements hâtifs et les simplifications réductrices. En somme, la psychosomatique, loin d’être obsolète, peut être réinventée. Elle appelle à un renouvellement des pratiques et des savoirs, ancrés dans une compréhension unifiée du corps et de l’âme. Cette réinvention passe par l’humilité, l’écoute et une véritable collaboration entre disciplines, pour faire du soin un espace où le corps et l’esprit s’entrelacent harmonieusement.
 III. ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JEAN BENJAMIN STORA
III. ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JEAN BENJAMIN STORA
Jean Benjamin, peux-tu nous aider à éclairer le passage de la psychosomatique analytique à la psychosomatique intégrative ?
Jean Benjamin Stora : Oui, en réalité c’est toute une histoire, mais c’est le paradigme d’un Anaxagore que j’ai remis en question, parce qu’il n’y a pas de clivage entre le corps et l’esprit. En me référant au Talmud, j’ai proposé un nouveau paradigme, l’être humain est une unité psychologique : il n’y a pas de maladies psychosomatiques, toutes les maladies sont psychosomatiques puisque nous sommes des êtres humains. Donc j’en suis arrivé à cette définition parce que, après avoir travaillé très longuement avec Pierre Marty (décédé en 1993), les collègues m’ont mis à l’écart de l’Institut de Psychosomatique, car il fallait continuer à appliquer le modèle de Freud conçu pour les patients névrosés. J’ai donc, avec l’aide de Jean-François Allilaire, créé une consultation à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Et c’est en 1993 que commence l’histoire de la psychosomatique intégrative, et je rencontre des patientes et des patients venant de tous les services.
L’anamnèse que je faisais de ces patients était problématique, car ces patients n’avaient pas, comme dans la névrose, de capacité associative, ni de retour présent-passé. Au fur et à mesure de nos rencontres, je constatais que lorsque ces patients me disaient quelque chose, je leur disais : « Mais à quoi cela vous fait-il penser ? » Ils ne pensaient à rien ! Et ils ne rêvaient pas et n’avaient pas d’imaginaire. Donc, j’étais complètement démuni face à ces patients, comment les soigner ?
Je me suis posé des questions à ce moment-là sur l’existence du système psychique. Comment un système psychique se développe-t-il chez un être humain ? Je me suis tourné d’abord vers Marty... il n’y avait rien ! Puis vers le Père de la psychanalyse : il n’y avait rien non plus ! Freud était un bourgeois de Vienne, et pour lui tous les êtres humains étaient névrosés. Pour moi, chez les patients psychosomatiques, il n’y a pas de névrose infantile. Cet intérêt pour les sujets non-névrosés a été repris dix ans après par André Green. Je me suis attaché énormément à la naissance du système psychique. Freud nous dit : « Le système psychique est composé de comportements, d’affects et de représentations mentales. » Je me suis alors interrogé sur les représentations mentales, et je me suis rendu compte que les patients psychosomatiques n’en avaient pas. Et Freud ne s’est jamais interrogé là-dessus. Jamais ! Et donc, il n’a jamais su comment un système psychique naissait chez un être humain. A ce moment-là, j’ai commencé à me tourner vers un certain nombre de pédiatres, de psychanalystes et de pédopsychiatres. J’ai rencontré René Spitz, psychanalyste hongrois, pédiatre, réfugié aux Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dirigé une clinique et progressivement il a développé une approche théorique nouvelle. C’est-à-dire que quand un être humain naît, il n’existe pas de système psychique. Donc, qu’est-ce qui existe ? Quelles sont les conditions pour qu’un système psychique puisse prendre naissance à partir de nos capacités cognitives ? J’ai constaté que c’est dans la relation à la mère, c’est elle qui met des mots sur les choses et qui crée avec son bébé, son enfant, des représentations mentales. Et pour que ces représentations mentales existent, il doit y avoir aussi un certain nombre de conditions neurologiques.
Quelles sont ces conditions ?
Spitz a créé deux organisations sur le mode pédiatrique, l’organisation coenesthésique et l’organisation diacritique. De quoi s’agit-il ? Il s’agit tout simplement, pour l’enfant, de l’encodage neuronal des sensations et de la motricité. Ces sensations visuelles, auditives, gustatives, olfactives, toutes les sensations sont encodées dans le cortex que nous connaissons, le cortex sensoriel et moteur, qui permettent à un être humain de grandir. Et c’est à partir de cet encodage que progressivement les représentations mentales peuvent se développer, mais pas avant. Donc, pour des raisons qui sont propres à l’histoire de mes patientes et de mes patients, il y a eu des défaillances dans l’encodage et dans la relation maternelle. Il y a eu des carences parentales, qui ne se réparent pas tout de suite et entravent le développement d’un système psychique. A ce moment-là j’ai été plus loin dans la thérapie, en me disant puisque c’est la mère qui éduque l’enfant, il est important d’avoir, dans la thérapie psychosomatique, une attitude maternelle, une relation d’attachement.
Pourquoi ?
Parce que quand l’objet premier, c’est-à-dire la relation maternelle, est internalisé (Spitz, mais des pédiatres aussi nous le disent, des pédopsychiatres), cela met neuf mois. C’est seulement au terme du neuvième mois que la mère est internalisée. Et c’est à ce moment-là que le système psychique peut se développer.
Pour lire la suite...
Pr Jean Benjamin STORA
Professeur émérite français, psychanalyste et psychosomaticien. Né le 13 octobre 1934 à Constantine en Algérie. Docteur en droit, docteur ès sciences économiques. Psychologue clinicien, psychanalyste (formé à la SPP depuis 1973), psychosomaticien qualifié depuis 1985, créateur d'une consultation de psychosomatique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (1993 2015). A mis en place un diplôme universitaire de psychosomatique intégrative à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière en 2006. Fondateur de l'institut de psychosomatique intégrative en 2015. Auteur de nombreux ouvrages et publications scientifiques sur le stress la psychosomatique et la neuropsychanalyse.
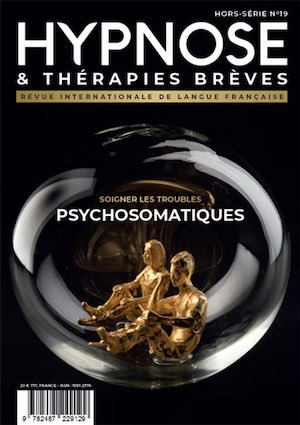 Soigner les troubles psychosomatiques
Soigner les troubles psychosomatiques
Sommaire du hors-série n°19
Merci à Eric Bardot et Stéphane Roy d’avoir co-dirigé ce « Hors-Série » de 196 pages sur les troubles psychosomatiques : chacun pourra y découvrir l’importance de la psychodynamique relationnelle et de l’imaginaire pour soutenir la démarche thérapeutique et permettre à chacun d’habiter son corps.
Les trois premiers articles s’ouvrent sur la clinique dermatologique... A travers l’histoire très émouvante de Lucas, 4 ans, souffrant d’eczéma, Virginie Bardot propose de mettre en forme le monde relationnel familial figé dans lequel les symptômes de l’enfant sont tout puissants. En réintroduisant le jeu, et en s’appuyant sur un scénario imaginaire co-construit avec l’enfant, les parents pourront se reconnecter à la souffrance de leur fils, retrouver leur capacité à prendre soin de lui de façon inconditionnelle et lui permettre de retrouver des relations sécures.
Stéphane Roy nous rappelle comment le déficit de l’imaginaire et des affects nécessite de travailler d’une manière relationnelle, émotionnelle et systémique. Il nous fait comprendre comment la TLMR (Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels) est une technique de choix dans le traitement des troubles psychosomatiques. Avec Martine, atteinte de psoriasis à plaques géant, nous voyons comment la capacité de donner une existence symbolique au symptôme physique va lui permettre de se reconnecter à une histoire de vie porteuse de sens.
Véronique Bonnet nous fait partager son expérience relationnelle de dermatologue avec deux patientes : l’une souffrant de rougeurs chroniques du visage, et l’autre de douleurs à type de brûlures post-zona. Lisez ces beaux témoignages et vous découvrirez comment le « vertige de l’amour » d’Alain Bashung nous fait sentir le lien vivant entre la peau et le cœur.
Avec Eric Bardot, vous ferez la connaissance de Marie, 34 ans, qui rêve d’être une fille parfaite et une employée modèle. Malheureusement, elle s’enferme dans le silence et une boule dans la gorge ainsi que des maux de tête l’envahissent depuis de nombreux mois. L’auteur, concepteur de la TLMR, nous montre son savoir-faire et sa pédagogie pour créer un chemin qui donne le droit à Marie de respirer et d’exister.
Gérard Ostermann nous rappelle l’importance de dépasser la dichotomie corps-esprit pour s’engager dans une médecine plus holistique bio-psycho-sociale.
Il nous ouvre à la compréhension de la psychosomatique intégrative développée par le professeur Jean Benjamin Stora. Vous lirez la présentation et l’interview de ce chercheur et clinicien, figure majeure dans le domaine de la psychosomatique.
Pour Gérald Brassine la psychosomatique rejoint la liste des phénomènes hypnotiques dotés d’une fonction protectrice puissante. A partir d’un cas de polyarthrite rhumatoïde, il met expérimentalement en évidence comment la douleur somatique protège de douleurs émotionnelles que le sujet ne parvient pas à assimiler. Le travail en PTR (Psychothérapie Trauma Réassociative) consiste à transformer le souvenir traumatique et les émotions afférentes pour sortir de la rigidité des défenses psychosomatiques.
Dans son article, Mady Faucoup aborde la question de la honte en psychosomatique, à propos de deux patientes de 50 ans à la recherche d’une plus grande liberté et qui souffrent de sensations de brûlures au cou. Nous saisissons l’importance d’externaliser le problème sur une scène métaphorique et d’utiliser des mouvements alternatifs pour permettre à ces femmes de retrouver une expérience d’unité corporelle.
Pierre Pétillot, ostéopathe et praticien en hypnose, insiste sur le lien entre les douleurs et les émotions. A travers deux situations cliniques (algodystrophie du genou et douleurs abdominales), nous découvrons une pratique où l’accordage, les temps de réflexion et de co-construction d’un espace commun permettent une prise en charge holistique du soin, le sujet devenant pleinement acteur de sa guérison.
Les kinésithérapeutes sont également confrontés à des patients souffrant de douleurs figées dans des constructions identitaires. Marie-Anne Jolly nous présente le cas d’un homme ayant des douleurs sur tout le côté gauche de son corps. Elle insiste sur l’authenticité des échanges afin que le patient perçoive le thérapeute comme un témoin de vie lui permettant de se relier à sa mobilité relationnelle.
L’article suivant concerne le diagnostic de trouble fonctionnel intestinal chronique associé à un syndrome anxiodépressif atteignant de nombreux patients. Dans ce cadre, Stéphane Radoykov nous présente l’utilisation des signaux idéomoteurs en hypnothérapie pour faire émerger un contexte où la prise de décision sera le premier pas vers un grand changement.
Pour terminer le voyage, Pierre Kivits nous emmène dans l’œuvre de Marcel Proust, un des plus grands auteurs du XXe siècle. Comme avec tous les grands écrivains, le lecteur rentre en transe et vit les expériences intérieures et sensorielles du héros engagé dans une quête de vérité. L’originalité de cet article est de nous faire découvrir le VAKOG de Proust, ou comment l’écrivain asthmatique a pu libérer sa créativité en se connectant à sa sensorialité.
Enfin, pour clore toutes ces riches réflexions, Eric Bardot, Julien Betbèze et Stéphane Roy nous proposent un échange à trois voix pour comprendre la transe comme un processus de protection et d’activation de l’autonomie relationnelle. Encore merci à tous les auteurs : leur expérience, leur créativité et leur complémentarité ont permis de construire un numéro passionnant.
- Thérapies et Médecines Complémentaires
- Medecines Complémentaires
- Affichages : 662

