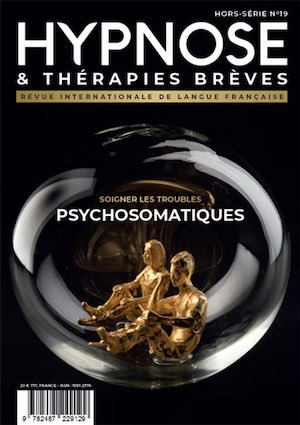La controverse de la médecine psychosomatique.

ENTRE CORPS ET ESPRIT, UNE FRACTURE MÉDICALE ET PHILOSOPHIQUE
Retour aux sources anciennes du concept de la « psycho-somatique », fondement d’une approche plus holistique de la maladie, et qui pourrait annoncer une médecine du futur plus attentive aux dimensions émotionnelles et sociales des patients.
Une médecine aux frontières de l’invisible
Johann Heinroth aurait le premier employé le mot psycho-somatique, en 1818, mais avec un trait d'union qui restera un objet de litige, car signe dialectique. Le terme est repris par Felix Deutsch en 1922, sans trait d’union. Il sera introduit en France par Delay et coll. en 1946. La médecine psychosomatique suscite depuis des décennies une controverse profonde, divisant le corps médical, les philosophes, et même les patients. Cette discipline repose sur l’idée que les troubles physiques ne trouvent pas toujours leur origine dans une cause biologique identifiable, mais peuvent aussi découler d’un déséquilibre psychologique ou émotionnel. A la croisée des chemins entre le corps et l’esprit, la médecine psychosomatique remet en question les fondements mêmes de la médecine moderne, qui privilégie une approche dite cartésienne fondée sur la séparation stricte de ces deux dimensions.
Cette controverse soulève des questions majeures : le corps est-il une simple machine biologique, ou bien un système complexe influencé par les émotions, les pensées et l’inconscient ? Comment prouver scientifiquement l’influence du psychisme sur le corps ? Et surtout, quelles implications éthiques et thérapeutiques en découlent ?
La genèse d’une controverse : le corps et l’esprit, une dichotomie historique
La controverse autour de la médecine psychosomatique trouve ses racines dans l’histoire de la pensée occidentale. Depuis l’Antiquité, les médecins ont cherché à comprendre le lien entre le corps et l’âme. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, croyait déjà que les émotions et les humeurs pouvaient influencer la santé physique. Cependant, au XVIIe siècle, René Descartes établit une rupture nette entre le corps, considéré comme une machine, et l’esprit, une entité immatérielle indépendante.
Cette vision dualiste a façonné la médecine moderne. La médecine scientifique, apparue au XIXe siècle, a renforcé cette approche en se concentrant exclusivement sur les mécanismes biologiques et en écartant toute dimension subjective. Les maladies ont été classifiées, les symptômes analysés, les traitements standardisés. Mais cette approche mécaniste a laissé peu de place à la prise en compte des facteurs psychologiques, qui étaient relégués au domaine de la psychanalyse et de la philosophie. C’est au XXe siècle que la médecine psychosomatique réapparaît, portée par des figures comme Sigmund Freud, Franz Alexander et George Engel. Ces pionniers affirment que certaines maladies – comme les ulcères, l’asthme ou les maladies cardiaques – ne peuvent être comprises qu’en tenant compte des interactions entre le corps et le psychisme.
Les arguments des partisans d’une médecine plus holistique
Les défenseurs de la médecine psychosomatique prônent une approche holistique de la santé. Ils considèrent que le corps et l’esprit forment un tout indissociable, et que la prise en charge médicale doit inclure les dimensions psychologiques et émotionnelles du patient. C’est donc une approche holistique de la maladie qui rappelle que l’homme a une âme chevillée au corps, un psychisme qui coiffe et intègre les organes.
C’est ainsi que pour Jakob von Uexküll la médecine psychosomatique est « une branche de la médecine qui concerne l’étude des phénomènes de l’esprit et leur signification dans l’apparition et le développement des maladies affectant le corps ». En réalité, plutôt qu’une branche de la médecine, il s’agit d’un nouvel esprit médical selon lequel toutes les maladies sont psychosomatiques puisqu’elles concernent toujours un homme vivant, animal doué de langage et de pensée sinon de raison.
a) L’évidence clinique : quand le stress rend malade De nombreuses études montrent l’impact du stress, de l’anxiété et des traumatismes sur le corps. Le stress chronique, par exemple, est associé à des maladies cardiovasculaires, des troubles digestifs, des migraines et une baisse du système immunitaire. Les troubles psychosomatiques sont courants, mais souvent mal diagnostiqués, car les médecins cherchent d’abord une cause biologique identifiable.
Les partisans de la médecine psychosomatique mettent en avant des cas où les symptômes physiques ne disparaissent que lorsque le patient traite ses conflits émotionnels sous-jacents. Par exemple, des patients souffrant de douleurs chroniques inexpliquées voient leurs symptômes diminuer après une thérapie psychologique.
b) La théorie du modèle bio-psycho-social
En 1977, George Engel propose le modèle bio-psycho-social, qui devient une référence dans la médecine psychosomatique. Ce modèle soutient que la santé est le résultat d’une interaction complexe entre des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Pour Engel, il est impossible de comprendre une maladie en ne tenant compte que du corps biologique. Il faut aussi considérer le contexte de vie du patient, ses relations sociales et son état émotionnel.
3. Les arguments des opposants : une médecine trop subjective ? Malgré ces avancées, la médecine psychosomatique reste critiquée par une partie du corps médical. Les opposants mettent en avant plusieurs arguments.
a) L’absence de preuves scientifiques objectivables
L’une des critiques majeures porte sur le manque de preuves scientifiques solides. La médecine moderne repose sur des données objectives et reproductibles, alors que les troubles psychosomatiques sont difficiles à mesurer. Comment prouver que le stress a déclenché une maladie, plutôt qu’un facteur biologique ? Cette absence de preuves tangibles rend la discipline vulnérable aux critiques.
b) Le risque de stigmatisation des patients
Les opposants craignent aussi que la médecine psychosomatique entraîne une stigmatisation des patients. En attribuant une maladie à un trouble psychologique, il existe un risque que les médecins minimisent les symptômes physiques ou considèrent les patients comme responsables de leur état de santé. Certains patients se sentent incompris, voire culpabilisés, lorsqu’on leur dit que leur maladie est « dans leur tête ».
c) Le danger d’un retour au spiritualisme médical
Enfin, certains médecins redoutent que la médecine psychosomatique ouvre la porte à des pratiques médicales non scientifiques ou alternatives. Le danger serait de tomber dans un spiritualisme médical, où l’on chercherait des causes mystiques ou émotionnelles à chaque maladie, au détriment des avancées biologiques et pharmacologiques.
4. Une synthèse possible : vers une médecine intégrative ?
Plutôt que de rester dans une opposition stérile, certains chercheurs plaident pour une synthèse entre médecine biologique et médecine psychosomatique. Cette approche, appelée « médecine intégrative », combine les traitements biologiques avec une prise en charge psychologique et sociale.
a) La place de la méditation, de la pleine conscience et de la psychothérapie
Les thérapies complémentaires, comme la méditation, la pleine conscience, et les thérapies cognitivo-comportementales, gagnent en popularité. Ces méthodes visent à réduire le stress et à améliorer la qualité de vie des patients, en complément des traitements médicaux traditionnels.
b) La médecine narrativo-thérapeutique
Une autre approche prometteuse est la médecine narrative, qui consiste à écouter le récit de vie du patient pour mieux comprendre son état de santé. Cette pratique permet de mieux cerner les facteurs émotionnels qui influencent la maladie et de proposer un traitement adapté.
CONCLUSION : UNE MÉDECINE DU FUTUR, ENTRE SCIENCE ET HUMANITÉ
La controverse autour de la médecine psychosomatique révèle une tension profonde entre deux visions de la santé : l’une, scientifique et matérialiste, cherchant des causes biologiques précises ; l’autre, holistique et humaniste, reconnaissant l’influence du psychisme sur le corps. Dans un monde où les maladies chroniques et les troubles mentaux sont en constante augmentation, il est essentiel de dépasser cette opposition. La médecine du futur devra être à la fois rigoureuse sur le plan scientifique et attentive aux dimensions émotionnelles et sociales des patients. Car, audelà de la controverse, une vérité demeure : le corps et l’esprit ne peuvent être séparés. Ils coexistent, s’influencent et se guérissent mutuellement.
Pr Gérard OSTERMANN : Professeur de thérapeutique, médecine interne, psychothérapeute. Administrateur de la Société́ française d’alcoologie, responsable du diplôme d’université́ de Pathologie de l’oralité, Bordeaux 2.
Merci à Eric Bardot et Stéphane Roy d’avoir co-dirigé ce « Hors-Série » de 196 pages sur les troubles psychosomatiques : chacun pourra y découvrir l’importance de la psychodynamique relationnelle et de l’imaginaire pour soutenir la démarche thérapeutique et permettre à chacun d’habiter son corps.
Les trois premiers articles s’ouvrent sur la clinique dermatologique... A travers l’histoire très émouvante de Lucas, 4 ans, souffrant d’eczéma, Virginie Bardot propose de mettre en forme le monde relationnel familial figé dans lequel les symptômes de l’enfant sont tout puissants. En réintroduisant le jeu, et en s’appuyant sur un scénario imaginaire co-construit avec l’enfant, les parents pourront se reconnecter à la souffrance de leur fils, retrouver leur capacité à prendre soin de lui de façon inconditionnelle et lui permettre de retrouver des relations sécures.
Stéphane Roy nous rappelle comment le déficit de l’imaginaire et des affects nécessite de travailler d’une manière relationnelle, émotionnelle et systémique. Il nous fait comprendre comment la TLMR (Thérapie du Lien et des Mondes Relationnels) est une technique de choix dans le traitement des troubles psychosomatiques. Avec Martine, atteinte de psoriasis à plaques géant, nous voyons comment la capacité de donner une existence symbolique au symptôme physique va lui permettre de se reconnecter à une histoire de vie porteuse de sens.
Véronique Bonnet nous fait partager son expérience relationnelle de dermatologue avec deux patientes : l’une souffrant de rougeurs chroniques du visage, et l’autre de douleurs à type de brûlures post-zona. Lisez ces beaux témoignages et vous découvrirez comment le « vertige de l’amour » d’Alain Bashung nous fait sentir le lien vivant entre la peau et le cœur.
Avec Eric Bardot, vous ferez la connaissance de Marie, 34 ans, qui rêve d’être une fille parfaite et une employée modèle. Malheureusement, elle s’enferme dans le silence et une boule dans la gorge ainsi que des maux de tête l’envahissent depuis de nombreux mois. L’auteur, concepteur de la TLMR, nous montre son savoir-faire et sa pédagogie pour créer un chemin qui donne le droit à Marie de respirer et d’exister.
Gérard Ostermann nous rappelle l’importance de dépasser la dichotomie corps-esprit pour s’engager dans une médecine plus holistique bio-psycho-sociale.
Il nous ouvre à la compréhension de la psychosomatique intégrative développée par le professeur Jean Benjamin Stora. Vous lirez la présentation et l’interview de ce chercheur et clinicien, figure majeure dans le domaine de la psychosomatique.
Pour Gérald Brassine la psychosomatique rejoint la liste des phénomènes hypnotiques dotés d’une fonction protectrice puissante. A partir d’un cas de polyarthrite rhumatoïde, il met expérimentalement en évidence comment la douleur somatique protège de douleurs émotionnelles que le sujet ne parvient pas à assimiler. Le travail en PTR (Psychothérapie Trauma Réassociative) consiste à transformer le souvenir traumatique et les émotions afférentes pour sortir de la rigidité des défenses psychosomatiques.
Dans son article, Mady Faucoup aborde la question de la honte en psychosomatique, à propos de deux patientes de 50 ans à la recherche d’une plus grande liberté et qui souffrent de sensations de brûlures au cou. Nous saisissons l’importance d’externaliser le problème sur une scène métaphorique et d’utiliser des mouvements alternatifs pour permettre à ces femmes de retrouver une expérience d’unité corporelle.
Pierre Pétillot, ostéopathe et praticien en hypnose, insiste sur le lien entre les douleurs et les émotions. A travers deux situations cliniques (algodystrophie du genou et douleurs abdominales), nous découvrons une pratique où l’accordage, les temps de réflexion et de co-construction d’un espace commun permettent une prise en charge holistique du soin, le sujet devenant pleinement acteur de sa guérison.
Les kinésithérapeutes sont également confrontés à des patients souffrant de douleurs figées dans des constructions identitaires. Marie-Anne Jolly nous présente le cas d’un homme ayant des douleurs sur tout le côté gauche de son corps. Elle insiste sur l’authenticité des échanges afin que le patient perçoive le thérapeute comme un témoin de vie lui permettant de se relier à sa mobilité relationnelle.
L’article suivant concerne le diagnostic de trouble fonctionnel intestinal chronique associé à un syndrome anxiodépressif atteignant de nombreux patients. Dans ce cadre, Stéphane Radoykov nous présente l’utilisation des signaux idéomoteurs en hypnothérapie pour faire émerger un contexte où la prise de décision sera le premier pas vers un grand changement.
Pour terminer le voyage, Pierre Kivits nous emmène dans l’œuvre de Marcel Proust, un des plus grands auteurs du XXe siècle. Comme avec tous les grands écrivains, le lecteur rentre en transe et vit les expériences intérieures et sensorielles du héros engagé dans une quête de vérité. L’originalité de cet article est de nous faire découvrir le VAKOG de Proust, ou comment l’écrivain asthmatique a pu libérer sa créativité en se connectant à sa sensorialité.
Enfin, pour clore toutes ces riches réflexions, Eric Bardot, Julien Betbèze et Stéphane Roy nous proposent un échange à trois voix pour comprendre la transe comme un processus de protection et d’activation de l’autonomie relationnelle. Encore merci à tous les auteurs : leur expérience, leur créativité et leur complémentarité ont permis de construire un numéro passionnant.
- Thérapies et Médecines Complémentaires
- Medecines Complémentaires
- Affichages : 450